A son exemple, d'autres sources d'une
moindre importance ont ressurgi de dessous
la coulée de lave et sur tout son long.
Ainsi, sortant de son flanc sud, on peut
rencontrer la source de la Fridière en amont
du pont portant le même nom, celle du Thieu
en contrebas de l'ancien cimetière, et plus
bas celle dite "de Denis", qui se jettent
dans la Monne. Au nord, en amont de la
Veyre, c'est la source de Vocan.
De la source de Cladeyrat, utilisée au
XIXème jusqu'à la moitié de ce siècle il ne
peut être question puisque son utilisation a
nécessité d'énormes tra-vaux de captages.
Toutes ces sources ont été aména-gées par
l'homme : on retrouve de vieilles cartes
postales montrant le lavoir de la Fridière
avec des Saturni-noises y lavant leur linge,
les autres ont été captées au moyen d'un
conduit maçonné...
Cependant, au nord, la coulée est moins
abrupte que les gorges de son flanc sud. La
Veyre est plus lointaine, et entre elles
deux, le sol pouvait être creusé : des puits
ont été pratiqués afin d'atteindre la nappe
phréatique. Si on remonte aujourd'hui la rue
Principale, on peut en dénombrer quelques
uns sur la droite.
Il en existe ainsi un dans le jardin de
Monsieur et Madame Delteil, qui a la
réputation d'avoir alimenté tout le quartier
environnant les années de grande sécheresse,
car lui n'était jamais dépourvu d'eau.
Il y a celui de la place du Poids de Ville,
protégé par une petite construction, mais
aujourd'hui totalement muré pour des raisons
de sécurité.
Il y en avait un, place de la Mairie, mais
il a été recouvert d'une grande dalle puis
par le goudron, et un autre subsiste encore
en amont à Rochemanie, etc...
Force est de constater que ces différents
points d'eau ont quelque chose de flagrant
en commun : ils sont tous situés en
contrebas de la butte du haut Saint
Saturnin, du village ancien. Les plus
éloignés d'entre eux sont matérialisés par
l'implantation d'une maison forte ou d'un
hameau : c'est le cas de Vocan, Rochemanie,
Pagnat, peut-être même du quartier d'Issac
(il s'agit d’un quartier qui s'est toujours
un peu démarqué de Saint Saturnin, qui
devait être à l'origine un petit hameau le
jouxtant, il commence à peu près au
restaurant de la Toison d'Or). Mais oublions
ces derniers points d’eau,
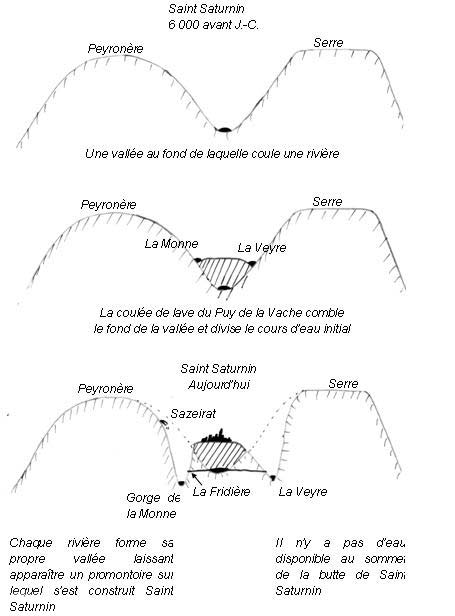 |
leur
indépendance les rend sans rapport
avec le problème du haut du village.
Nous voici donc avec des Saturninois
entourés d'eau, mais devant
parcourir à chaque fois de réelles
distances pour s'approvisionner :
soit descendre la rude pente menant
à la Monne pour trouver une source,
soit aller de l'autre côté à la
rencontre d'un puits.
Une remarque au passage : avez-vous
déjà observé que sur le dessin de
Guillaume Revel, représentant Saint
Saturnin en 1450 (Bulletin ASG n°
16), une des portes des
fortifications descend vers la Monne
? Cet accès permettait sans doute
d'atteindre la rivière, mais
surtout, il avait dû être pratiqué à
cet endroit pour pouvoir aller à la
source du Thieu (on remarque marque
très bien, au-dessus, les tombes de
l'ancien cimetière). Cette source
aujourd'hui oubliée par la plupart
devait être un des pôles de la vie
des Saturninois.
Donc, l'eau potable était à peu près
assurée malgré son accès difficile.
Mais on sait que l'un des fléaux des
temps anciens était constitué par
les incendies qui régulièrement
ravageaient les habitations du fait
de l'omniprésence du feu dans la vie
quotidienne. C'est sans doute cette
préoccupation qui provoqua la
nécessité d'amener de l'eau au plus
près des maisons et fit construire
par les habitants des citernes.
DES PALLIATIFS AU MANQUE D’EAU
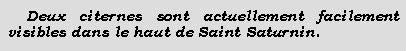
Sans pouvoir les dater, elles
demeurent néanmoins les témoins
d'une carence en eau et des efforts
des habitants pour l'approcher de
leurs habitations.
La première se trouve rue des
Nobles, dans le soubassement de la
terrasse de Monsieur et Madame André
Beraud. Elle servait à recueillir
l’eau pluviale drainée en amont par
la rue. |
Là, l'accueillait
une sorte de bassin de décantation à partir
duquel elle était menée jusqu'à une citerne
donnant sur une cour intérieure. Tout ce
système a sans aucun doute été refait au
début de ce siècle.
La seconde est appuyée contre le mur du
jardin de Monsieur et Madame Humbert Jacomet
un peu plus bas dans la même rue.
Cette eau, bien entendu, ne pouvait être
qu'une eau d'appoint : non potable et
irrégulière dans sa quantité, elle ne devait
que compléter l'apport des sources dont il a
déjà été fait état.
Et puis dans cette quête des points d'eau,
on pense quant même à la belle fontaine de
la place de l'Ormeau. Bien sûr, elle n'est
que le moyen de la diffusion de l'eau d'une
source et non pas source en elle même. Mais
justement, comment expliquer sa présence au
beau milieu de ce village dépourvu d'eau :
quelle eau pouvait bien être conduite
jusqu'à elle ?
Toutes les sources répertoriées précédemment
sont en contrebas, leur eau ne pouvait donc
pas, sans une pompe, être conduite jusqu'à
elle. Il s'agissait peut-être d'une autre
source, située en hauteur. Mais alors cela
suppose un certain éloignement et en tout
cas l'emploi d'un système complexe pour
conduire l'eau jusqu'à la place de l'Ormeau.
Peut-on raisonnablement songer à une pompe ?

Une étude de Madame
Agnès Guillaumont (Bulletin de l’Académie
des Sciences Belles Lettres et Arts de
Clermont-Ferrand) permet de dater avec
précision cette fontaine et d'envisager quel
système serait le plus plausible.
"Son ensemble reste très gothique dans son
décor, l'entrecroisement des branches et les
rosettes peuvent indiquer des rinceaux de la
première Renaissance, mais d'une manière
très frustre".
Sur le fût est répétée deux fois
l'inscription du phylactère : "tel est mon
us". "L'écriture, la langue et l'esprit du
texte indiquent certainement la fin du XVème
siècle ou le début du XVIème siècle. On a
voulu faire parler la fontaine ou le
donateur : personnalisation ou devise de
celui dans les habitudes duquel entrent les
œuvres pour le bien public."
L'observation des blasons martelés, par
lumière rasante, a permis de les identifier
et par là-même de préciser la datation déjà
ébauchée. On y retrouve celui de la famille
de Broglie, mais qui à l'évidence a remplacé
de plus anciens au XVIIème siècle. Il y a
celui du comte Jean III de La Tour
d'Auvergne, marié en 1497 à Jeanne de
Bourbon Vendôme ; celui de cette dernière ;
enfin celui de l'alliance entre la famille
de La Tour d'Auvergne et celle de La
Trémouille (parents de Jean III : Bernard et
Louise mariés en 1444).
Jean III, contemporain de cette fontaine
décède en 1501, suivi peu après par sa femme
: cette fontaine a donc été construite entre
1497 (date de son mariage dont il est fait
état sur la fontaine) et 1501 (date de son
décès).
C'est donc à la fin de l'époque gothique, au
tout début de la Renaissance, que cette
fontaine a été construite (adieu la légende
de la reine Margot dont la générosité aurait
signé avec ce que l'on a longtemps pris pour
de petites marguerites). La fontaine est
celle de son arrière-grand-père.
A cette période il a donc fallu réaliser une
installation qui amène l'eau jusqu'à elle,
au cœur du village (si elle n'a pas été
déplacée depuis), ou selon une autre
hypothèse tout aussi vraisemblable, dans la
cour du château.
Récapitulons les composantes nécessaires :
- une source située en hauteur pour que la
pente suffise à conduire l'eau car la pompe
n'est pas envisageable,
- cette source ne pouvant être immédiatement
proche, un système pour la conduire jusqu'à
la fontaine.
La démonstration est peut-être un peu
grossière, mais on est naturellement enclin
à songer à la source de Sazeirat émergeant
des coteaux du Puy de Peyronère dominant
Saint Saturnin par-delà la Monne, et au
château d'eau dont la construction semble a
priori compatible avec l'époque évoquée. On
peut songer à associer les deux : le château
d'eau aurait pu être construit dans le but
d'alimenter la fontaine. Il pourrait donc
dater du début de la Renaissance.
Pour vérifier ou infirmer cette hypothèse,
la première démarche est d'aller sur place
afin de constater ce qu'il peut subsister du
système.
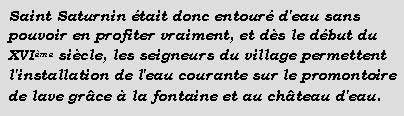
OBSERVATION SUR
PLACE : CE QUI EST ET A PU ETRE
La promenade à la recherche de ces vestiges
suivra le trajet emprunté par l'eau. Elle
commencera à la source de Sazeirat,
continuera au château d'eau, où se
trouveront peut-être encore quelques traces
de l'aqueduc, puis se terminera au
château-fort.
LA SOURCE DE SAZEIRAT ET SES ENVIRONS
IMMEDIATS
Pour se rendre jusqu'à elle, à pied de Saint
Saturnin, le chemin le plus court et
assurément le plus pittoresque, est celui
qui franchit, en contrebas du château, le
pont de la Fridière. Après avoir suivi sur
une bonne longueur le flanc de la coulée de
lave, on plonge vers la Monne pour remonter
abruptement sur les côteaux du Puy de
Peyronère. Le chemin d'origine a été emporté
par un éboulement, dans les années 20 ou 30,
ce qui forma un véritable barrage sur la
Monne. Il céda brutalement peu après,
inondant la zone du Pré-bas.
On finit par déboucher sur un chemin plus
large accessible aux automobiles, et, en le
suivant, à gauche, on en vient à longer une
parcelle boisée dans laquelle coule encore
la source de Sazeirat.
Sarcophage et conduites
Lorsque l'on se poste sur la bribe de chemin
qui surplombe la source de Sazeirat, on peut
apercevoir, dans le fossé limitant le champ
cultivé en amont, ce que tout le monde
connaît sous le nom de " La fontaine de
Sazei-rat". Aujourd'hui disparaissant dans
la mousse et les herbes folles, il s'agit du
bac en arkose qui recevait autrefois l'eau
de la source. Il est fracassé en plusieurs
morceaux, et sa forme indique qu'il
s'agissait à l'origine d'un sarcophage qui a
dû trouver là un réemploi.
La source était captée au-dessus de lui,
dans un champ aujourd'hui cultivé, mais qui
autrefois était un pré. Les labours profonds
ont détruit tout le captage et la source
s'est dispersée, ne devenant plus qu'un
modeste filet ressurgissant dans le bois en
contrebas. Des fragments de conduites en
céramiques ont pu être ramassés dans ce
champ : leur intérieur est vernissé.
D'ailleurs les chasseurs se souviennent
qu'un conduit bâti traversait le champ, et
ils savaient qu'au sarcophage, ils pouvaient
faire boire leurs chiens.
Dans le bois de Sazeirat
Le propriétaire de ce bois, Monsieur Michel
Aubry, a fait creuser une rase dans laquelle
s'écoule aujourd'hui le filet subsistant de
la source. La première chose que l'on
remarque en se penchant sur cette eau, est
qu'elle est extrêmement calcaire : la
moindre brindille, le moindre gravier se
trouvant sur son cours se trouve bientôt
recouvert d'une gangue de calcaire le
rendant méconnaissable.
De chaque côté de cette rase sont les
vestiges de deux constructions : du côté du
chemin, une voûte émerge, ressemblant à une
entrée de cave dont la façade
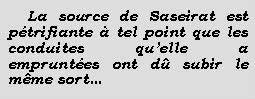 se serait effondrée ; du côté opposé, une
petite cabane ressemblant à celle des
bergers qui, cachée sous les broussailles a
reçu un malheureux coup de pelleteuse et est
aujourd'hui à peu près arasée.
se serait effondrée ; du côté opposé, une
petite cabane ressemblant à celle des
bergers qui, cachée sous les broussailles a
reçu un malheureux coup de pelleteuse et est
aujourd'hui à peu près arasée.
L'intérieur de la première semble avoir été
complètement rempli de terre suite à son
abandon, mais en y rentrant à quatre pattes,
on remarque une intrigante niche au fond,
carrée, bâtie grossièrement. On songe que
c'était peut-être par là que l'eau arrivait
autrefois, et que cette voûte cache
peut-être un bassin...
Quant à la deuxième construction, beaucoup
plus petite de proportions, elle avait cette
particularité, jusqu'à une époque récente,
d'être toujours pleine d'eau ...
Si l'on essaie de descendre en aval de ce
bois afin de retrouver la source dans son
itinéraire vers la Monne, il faut franchir
une incroyable barrière de broussailles et
s'approcher de la falaise surplombant la
rivière. Là on peut suivre une sorte de
muret très bas, et à son extrémité, les
concrétions de calcaire réapparaissent,
luisantes d'eau. Ce muret serait-il un bâti
destiné à protéger une conduite d'eau...
La « voûte » de Sazeirat en 1995
LE CHATEAU D'EAU
Autrefois englobé dans le parc du château de
Saint Saturnin, il fait au aujourd'hui
partie de la propriété de Monsieur André
Molles. Grâce à son autorisation et à
l'aimable collaboration de ses voisins, nous
avons pu observer la construction sous tous
ses angles et dans ses moindres recoins.
Situation et plan général
Le château d’eau se trouve aujourd'hui à
quelques mètres de la limite actuelle du
château. Situé au bord de la falaise
surplombant la Monne, à peu près dans
l'alignement de la source de Sazeirat qui le
domine de l'autre versant, il est édifié sur
un petit monticule de 3 à 4 mètres de haut
environ, d'origine volcanique sans nul
doute. Sa base est restée à l'état brut
d'accumulation de rochers basaltiques. Il a
été construit "au premier étage" et sa forme
a suivi les irrégularité de son assise.
« Au premier abord on pourrait prendre cette
construction pour une tour, un ancien donjon
abandonné, qui plus tard, aurait servi de
poste de défense avancé. Mais si l'on veut
l'examiner de près, on voit bientôt que l'on
a aucune ouverture, aucune meurtrière, rien
qui ait pu servir à la défense. C'est une
maçonnerie très serrée faite de chaux grasse
et de simples moellons pas trop gros et
parfaitement posés. Ses angles seuls sont en
pierres d'appareil ».
Telle est la description que fit en son
temps Monsieur du Ranquet, professeur à
l’Université de Clermont (notes inédites),
de l'aspect extérieur du château d'eau.
On le présente en général comme étant de
forme pentagonale (Messieurs G. de Bussac et
H. du Ranquet « SAINT-SATURNIN, « Le
Touriste en Auvergne », éditions Georges de
Bussac, 1959).
Il est difficile d'en juger de l'extérieur
puisque le lierre cache une grande partie de
ses murs. Si on grimpe jusqu'à une brèche
pratiquée dans l'un de ses murs, et que l'on
parvient à se glisser à l'intérieur, on ne
peut déterminer ce qui est angle et ce qui
ne l'est pas : l'ensemble est plutôt de
forme ronde ponctuée de petits angles
irréguliers.
Sur cette structure principale, vestige de
l'ancien réservoir, se greffe à l'extérieur
un mur rapporté, parallèle, qui, partant de
la base du monticule, atteint finalement le
haut de la construction, et, en un coude
rentre dans le mur de la structure porteuse.
On songe immédiatement à une rampe
permettant l'accès au réservoir, puisque
l'espace laissé entre les deux murs est
exactement celui nécessaire au passage d'un
homme et que son sol monte progressivement.
Dès lors se pose la question de savoir si
une porte existait.
Observons au préalable le fameux supposé
réservoir.
Le réservoir
Mise à part la « rampe d'accès », les murs
périphériques du château d'eau sont doubles.
Entre les deux parois qui sont de même
importance (environ 20 cm d'épaisseur), un
espace d'à peu près 50 cm de large a été
comblé avec de la terre glaise. Nous sommes
donc bien en présence du réservoir
proprement dit, au "premier étage", dont
l'étanchéité était assurée par la terre
glaise contenue entre ses doubles murs.
L'eau était donc conduite jusqu'a cette
hauteur.
Ce fut également la conclusion de Monsieur
du Ranquet lorsqu'il pénétra à l'intérieur
de la construction, alors en meilleur état
de conservation. « On se trouve sur une aire
horizontale et unie formée de terre glaise
battue dans laquelle croissent
malheureusement actuellement quelques
chétifs pieds de luzerne. Les murs s'élèvent
autour à 2,50 m environ au-dessus et,
s'amincissant à leur sommet, ils ne mesurent
plus que 50 cm d'épaisseur. Evidemment, nous
avions là un bassin. Tous les caractères y
sont : force de résistance au poids énorme
de l'eau obtenue par le doublement des
parois et étanchéité complète procurée par
le corroie de terre glaise qui l'enveloppe
de toute part ».
S'interrogeant également sur la couverture
du bâtiment (indispensable pour empêcher la
lumière d'entrer et limiter ainsi le
pourrissement de l'eau stagnante), il
propose l'hypothèse d'une voûte écroulée
depuis.
L'eau
L'eau était obligatoirement acheminée
jusqu'au réservoir, donc au "premier étage"
(nous considèrerons toujours le monticule
basaltique comme "rez-de-chaussée"). La
trace de son passage à cette hauteur a été
mise malheureusement en évidence par
l'écroulement d'une partie du sol intérieur
ayant entraîné avec lui la paroi intérieure
du double mur formant le coude sud-ouest
nord-ouest (côté Issac pour les Saturninois),
consécutivement à un travail de sappe
effectué à la base de la construction.
|

Deux conduites encastrées dans
un mur du château d’eau |
Il est ici
observé que le sol du réservoir
avait dû être lui-même construit sur
la base d'une voûte puisque cet
écroulement laisse entrevoir un vide
entre le rocher-support et la dalle
intérieure subsistante.
Ainsi, depuis cet évènement, ont été
mises à nu trois conduites autrefois
totalement encastrées dans les murs,
aujourd'hui ne tenant plus que sur
le pan de mur subsistant.
Si l'on considère qu'à cet endroit,
un "presqu'angle" existe, la
position des conduites est la
suivante :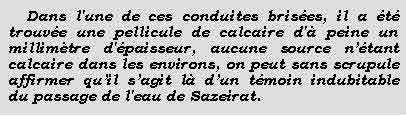
- l'une est horizontale dans le mur
sud-ouest,
- les deux autres sont verticales
dans le mur nord-ouest.
Si l'on descend de cette hauteur
pour se rendre à la base de
l'endroit d'où a dû être provoqué
l'éboulement, on peut observer le
trou pratiqué par le grand-père de
Monsieur Molles qui, maçon de son
état, avait commencé son projet de
démolition totale du château d'eau.
Il s'en est heureusement arrêté là.
Mais juste à côté, pas mal endommagé
par le même homme, subsiste un
couloir en cul-de-sac dont le
plafond est percé par des tuyaux.
Monsieur du Ranquet l’avait déjà
lui-même remarqué : « Si nous
faisons le tour de cette
construction extérieurement, au
sud-ouest, sous sa base, logée dans
une anfractuosité du rocher, nous
remarquons une niche à la voûte de
laquelle sont trois trous occupés
encore par des tuyaux en poterie.
Evidemment, nous avions là une
chambre de distribution. »
Ces tuyaux semblent bien
correspondre avec ceux observés au «
premier étage ». Il est en tout cas
curieux de constater que toutes les
conduites actuellement visibles et
la supposée chambre de distribution
soient toutes opposées au côté
d’arrivée de l’eau et pas non plus
en face du château-fort qu’elles
étaient sensées alimenter.
Un autre quartier du village
était-il concerné ? On aurait bien
envie de fouiller au pied de cette
chambre de distribution pour tenter
de retrouver le chemin suivi par les
conduites … |
Les énigmes d'une construction complexe
Ne connaissant pas de construction semblable
au château d’eau de Saint Saturnin, il est
difficile pour un non-expert de donner une
explication à toutes les particularités
architecturales de l’édifice. Ainsi, il y a
plus d’un détail intrigant auquel aucune
lumière n’a pu être apportée.
C’est le cas des angles et des arcs qui
ponctuent les « faces » externes du
réservoir : quatre « angles » sont visibles,
marqués par un bel appareillage en arkose
que l’on aperçoit sous le lierre, à la
manière du château fort lui-même. De même un
bel arc en arkose semble vouloir soutenir la
construction. Peut-être que la seule
explication à envisager est celle de la «
tendresse » de la pierre, qui, permettant
une taille plus facile, a été préférée.
Il y a aussi une cabane, a priori un simple
abri de jardin, qui s’adosse au château
d’eau à sa base. L’intérieur pourtant
déroute : il est crépi avec un enduit bien
régulier et fin, et il y a comme des
arrivées d’eau, la question est à
approfondir...
Enfin, Monsieur Molles nous montre quelque
chose qui était passé inaperçu (encore ce
fichu lierre !) : un trou encadré d’arkose
parfaitement taillée situé sur la façade
côté chemin. Gamin, il s’amusait à s’y
glisser, puis à monter jusqu’au sommet du
château d’eau en suivant le petit chemin en
pente qui en part. Ni une, ni deux, on tente
l’expérience. L’entrée est suffisante pour
nous laisser passer (mais pas plus), et il y
a toujours un passage, d’abord caché sous le
mur d’enceinte (un mètre environ), puis le
raidillon qui continu à l’air libre permet
d’atteindre le haut du mur. Mais là, le
mystère reste total : quel rôle attribuer à
cette espèce de « gouttière » ?
On peut aussi rappeler les énigmes tout à
l’heure évoquées :
- Quel accès pour l’homme à cette
construction ?
- Quel accès et quelle sortie pour l’eau
provenant de Sazeirat ?
- Quel rôle pour chacune des conduites
trouvées ?
- Quelle couverture pour la construction ?
L’AQUEDUC
Finalement, plus que le château d’eau
lui-même, c’est la légende de l’aqueduc qui
fait le plus rêver dans la complexe
installation qui nous intéresse. Mais c’est
elle également qui donne le plus de matière
aux sceptiques.
Tentons de faire un bilan : que nous disent
les habitants de Saint Saturnin lorsqu’on
leur demande ce qu’était exactement cet
aqueduc, et quels sont les arguments des
sceptiques pour leur faire conclure qu’il ne
peut s’agir là que d’une légende.
Ce que dit la tradition orale
Monsieur Henri du Ranquet, dans ses notes
déjà citées infra, reprend cette tradition
orale : « De l’autre côté du ravin, sur la
rive droite de la Monne, dans une prairie
haute située à mi côte sur les pentes du puy
de Peroneyre, existe une source presque
perdue aujourd'hui, mais qui, à ce
moment-là, vu les travaux que l’on fit alors
pour l’amener, devait être d’une certaine
importance. C’est cette source que les
seigneurs de Saint Saturnin résolurent de
conduite à leur château.
Elle était à proximité de Saint Saturnin et
son niveau permettait de l’y mener
facilement. Entre elle et la forteresse, il
y avait bien le ravin profond dans lequel
grondait la Monne. Mais qu’était cet
obstacle auprès de la puissance des Hauts
Seigneurs du lieu ? Ce ravin de 60 à 80
pieds de profondeur et de plus de 100 mètres
de large, on le franchirait. Les Romains
n’avaient-ils pas construit des aqueducs
pour faire passer des vallées aux eaux
qu’ils conduisaient à Arles, à Nîmes ou à
Lyon ? Pourquoi eux, seigneurs de Saint
Saturnin, de Saint Amant, de Montredon, de
Chanonat, de Tauves, de Montpeyroux et
autres lieux ne feraient-ils pas de même ?
C’est ainsi du moins que durent penser ces
hauts et puissants seigneurs.
Ils voulaient cette eau qui était chez eux
et ils n’hésitèrent pas à imiter les
vainqueurs du monde. Sur ce ravin ils
lancèrent un aqueduc hardi qui, de niveau,
conduisit les eaux de la source des flancs
de Perroneyre sur la coulée basaltique de
Saint Saturnin.
De cet aqueduc, nous n’avons plus que le
souvenir. Le temps, la main des hommes, une
force majeure, une cause on ne sait
laquelle, l’ont fait disparaître depuis
longtemps, mais son existence est
incontestable par le procès-verbal d’une
assemblée tenue par les habitants de Saint
Saturnin en 1773 (texte introuvable) et où
il en est fait mention ».
On raconte que la disparition de l’aqueduc
n’est pas surprenante puis qu'il aurait été
fait de bois, des troncs d’arbres évidés qui
se seraient bien naturellement totalement
dégradés. Il n’en serait donc resté pendant
un temps que les quelques piles de pierres
qui en soutenaient les piliers. Cependant,
comme tout tas de pierres, ils auraient
servi de carrière aux villageois,
disparaissant ainsi à leur tour.
Monsieur Bouillet (Erudit clermontois de la
fin du XIXème) affirme en voir encore les
vestiges, se gardant bien cependant de les
décrire, de telle sorte que le mystère reste
complet (in Département de Puy de Dôme,
1874).
Distances et problèmes
La foi de Monsieur du Ranquet dans la
puissance des Seigneurs de Saint Saturnin
semble être à modérer au vu du fameux ravin
: comment appuyer un aqueduc sur ses flancs
qui ne cessent de s’ébouler et lui faire
franchir une telle distance à une telle
hauteur ?
LE CHATEAU-FORT
Deux questions se posent à son sujet :
peut-on y trouver la trace de la citerne en
principe antérieure au château d’eau, et
peut-on y trouver des témoins de
l’utilisation de l’eau de Sazeirat ?.
La recherche d'une citerne
On ne connaît malheureusement aucune citerne
au château de Saint Saturnin.
Ses précédents occupants, lorsqu’ils avaient
fouillé l’intégralité de sa cour intérieure,
n’avaient découvert que la pièce enterrée de
la grosse tour de défense arasée. Toutes les
pièces du bâtiment sont aujourd’hui connues,
exception faite d’une seule : la pièce
enterrée de la tour aux mâchicoulis dont une
fenêtre est encore visible. La citerne s’y
trouve peut-être….
Une petite pièce située dans la cave
intrigue pourtant : une entrée à une hauteur
d’environ 1 m 20 du sol, puis un court
couloir (environ 2 m) permet d’atteindre
cette excavation ouverte sur son flanc, très
étroite. Y voir une citerne semble être à
exclure, car son revêtement ne semble pas
adapté, et il n’y a aucune trace d’ouverture
dans sa voûte qui aurait permis d’en
extraire l’eau.
La découverte de conduites
Les trois fragments
font désormais parties de la visite du
château.
Il ne s’agit que de fragments, mais ils sont
suffisamment éloquents
.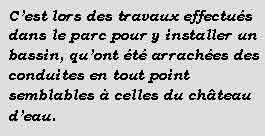
Leur intérieur est vernissé, de couleur
marron. L’extérieur est en céramique brute
rose. Les conduites s’emboîtaient les unes
dans les autres, disposant d’une extrémité
enflée, d’une autre plus étroite et d’un
cran de blocage. L’étanchéité de la jonction
de deux conduites était assurée :
- d’une part l’extrémité de la conduite qui
s’emboîtait dans la partie évasée de l’autre
était « enturbannée » de chanvre (ersatz de
nos joints de caoutchouc) ;
- d’autre part le bourrelet de cette même
extrémité était définitivement fixé à
l’autre par du mortier.
|

Fragments de
conduites trouvés dans
le parc du château |
Leur
découverte en plein milieu du parc
du château, dans l’alignement du
château d’eau, semble par ailleurs
indiquer que leur trajectoire était
en ligne droite.
Elle
devient cependant problématique
quand on envisage de les faire
arriver jusqu’au château :
l’obstacle des douves ne semble
guère surmontable.
CONFIRMATIONS ET DEMENTIS
L'idéal, pour mettre un terme à
toute hésitation au sujet de
l'utilisation du château d'eau de
Saint Saturnin, et clouer
définitivement le bec aux
sceptiques, était de trouver des
textes aussi anciens que possible
relatant sa fonction au sein du
village.
De surcroît la chance a voulu que la
Commune nous aide en décidant la
réfection de la Place de l’Ormeau,
ouvrant à notre lecture les
passionnants dessous du macadam.
Enfin il nous a été permis d’aller
un peu plus loin et de fouiller à
Sazeirat.
|
DEUX DECOUVERTES DETERMINANTES
Une visite aux Archives Départementales
était indispensable, car il s’agissait de ne
pas laisser passer la chance de trouver un
texte racontant au moins une partie de la
formidable histoire de l’aqueduc « fantôme »
de Saint Saturnin, d’autant que deux pistes
se proposaient :
- une référence au bas des pages consacrées
par Agnès Guillaumont à la fontaine de Saint
Saturnin, délibération du 14 janvier 1696
contenant un accord avec le comte de
Broglie, pour la conduite d'une source
appelée Sazeirat.
- Monsieur Manry, dans son "Histoire des
Communes du Puy-de-Dôme", qui cite "la
construction d'un pont de bois sur la Monne
grâce à la générosité du Marquis de Broglie
en 1748".
Cette recherche a suffi à apporter la preuve
si attendue.
Une délibération datée de1696
A la référence C. 2700 dans les répertoires
des Archives Départementales du Puy de Dôme,
on retrouve l’intitulé précité :
délibération du 14 janvier 1696 contenant un
accord avec le comte de Broglie, pour la
conduite d'une source appelée Sazeirat
jusque dans le château et la place de Saint
Saturnin, et pour la construction d’un pont
en bois sur la Monne.
Son contenu fait honneur à son intitulé :
« Aujourd’hui 14 janvier 1696 a été faite
assemblée générale des habitants de Saturnin
convoqués à la manière accoutumée au son de
la grande cloche à laquelle ont assisté
effectivement Antoine Villot…, Mr François
Verdier, Mr Gaspard Verdier bourgeois, Mr
Louis…, Mr Jacques Gougaud…, Jacques Cellier
Courtier, Sébastien Cellier, … Cellier, Jean
Cellier, Jean Roux, Mme Blaise Vatail, Jean
Taupier, François Cellier, …Jean Mangaud (…)
Faisant la majeure partie des habitants de
ladite paroisse de Saint Saturnin auxquels a
été remontré par MM Jean Villot bourgeois et
Jean Rouchon aussi bourgeois dudit Saint
Saturnin que Monseigneur le Comte de Broglie
étant dans son château audit Saint Saturnin,
les a mandé venir et leur a dit et fait
entendre…
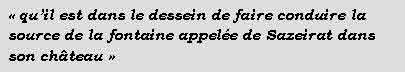
…dudit Saint Saturnin et de donner quelque
partie suffisant aux habitants pour une
fontaine qu’il prétend faire construire dans
la place duquel Saint Saturnin sous le bon
plaisir le Monsieur Monseigneur vu la
nécessité qu’ont lesquels habitants tant
pour eux personnellement leurs bestiaux que
pour éviter les incendies qui pourraient
arriver dans ledit lieu de Saint Saturnin et
attendu la nécessité qu’il y a de faire un
pont de bois (…) sur la rivière de la Monne
pour le service des habitants pour aller
cultiver leurs terres et pour le passage des
eaux de ladite fontaine.(1)
Monsieur Monseigneur a offert de fournir
tout le bois nécessaire tant pour la
construction dudit pont que pour faire les
tuyaux pour conduire les eaux de ladite
fontaine lequel bois Monseigneur fera
conduire dans son château pour y être
ouvragé prêt à poser lequel lesdits
habitants s’obligent de faire conduire aux
lieux nécessaires à condition que lesquels
habitants fournissent tout le surplus de la
dépense pour ladite conduite.
Soit manœuvre, chaux, sable, parement,
plomb et autres matériaux nécessaires et
pour couvrir la dépense… (2).
Devant Monsieur le […], requérant lesdits
sieurs Villot et Rouchon… délibération de
l’assemblée lesquels habitants après avoir
mûrement considéré la nécessité qu’ils ont
d’un pont pour le service des terres qu’ils
ont au-delà de l’eau de la Monne et qu’il
faut faire une fontaine à la place dudit
Saint Saturnin vu l'éloignement des autres
fontaines donneront pouvoir et charge
auxquels sieurs Villot et Rouchon bourgeois
de supplier Monseigneur de leur accorder
ladite fontaine et de fournir suivant
lesdites propositions les bois et tuyaux
nécessaires pour la conduite de ladite
source et fontaine soit dans son château et
que celle-ci qui sera conduite à la place de
Saint Saturnin… (3)
(suit toute une explication du coût)
…et quant aux réparations qu’il conviendra
de faire pour l’entretien pour les fuites
desdites fontaines lesquels habitants
s’obligent de les faire pour moitié avec
Monsieur seigneur jusqu’au réservoir au tout
[…] et du réservoir aux fontaines qui seront
dans les places.
Lesdits habitants s’obligent de faire les
réparations à leurs frais et dépend et comme
tel est nécessaire qu’un homme puisse
veiller au travail et donne les soins pour
l’avancement dudit ouvrage lesdits habitants
ont nommé le sieur Limoulie auquel tel ont
accordé pour les peines la somme de 75
livres pour tous les soins qu’il donnera
pendant tout le temps de la construction de
ladite fontaine
Laquelle somme de 75 livres sera déduite sur
celle de 275 que la […] doit à ladite
commune, au cas qu’il soit nécessaire de
poser les tuyaux de la fontaine dans les
terres et héritages d’aucun particulier
habitant de ladite paroisse.
Il sera loisible de faire ce … à moindre
dommage que faire le pourra ce qui a té
accordé par les habitants ci présents.
A aussi délibéré que les consuls de l’année
présente seront tenus de faire la manœuvre à
tous les habitants de ladite paroisse chacun
à son tour et tel nombre que requis sera aux
fins susdite »
COMMENTAIRES DU TEXTE DE 1696
(1)Un itinéraire inattendu
Il s’agit donc ici, non seulement d’amener
l’eau jusque dans la demeure seigneuriale,
mais aussi sur la place du village. Et de
cet itinéraire, il n’en avait jamais été
question dans la tradition orale.
On pourrait se poser la question de savoir
de quelle place il s’agit, mais la manière
dont elle est désignée ne laisse a priori
pas de doute : c’est « la place » du village
ancien, l’actuelle place de l’Ormeau.
On peut noter l’ambivalence du terme «
fontaine », qui est à la fois utilisé pour
désigner la source et la fontaine proprement
dite. Mais lorsqu’il s’agit de la source, à
chaque fois son nom est précisé « Sazeirat
». On ne connaît d’ailleurs pas aujourd’hui
d’autres fontaines contemporaines ou plus
ancienne que celle de la place de l’Ormeau.
A ce sujet une autre question se pose : il
est expressément dit dans ce texte qu’ils
comptent la « construire ». Il ne semble pas
que l’hypothèse de la construction d’une
nouvelle fontaine à cette époque soit à
retenir. Tout semble se baser sur du
préexistant.
Notre fontaine donc, n’étant plus alimentée
du fait de la rupture du pont en contrebas,
était hors d’état de fonctionnement, sans
doute alors avait-elle subi des
détériorations, comme la perte de son
étanchéité par exemple ou tout simplement
suite à un manque d’entretien prolongé.
En tout cas voici la preuve irréfutable du
fonctionnement effectif du système décrit,
et qui se révèle de surcroît encore plus
complexe et important pour le village
puisqu’on apprend qu’il alimentait sa place
principale.
On peut noter ici que la présence d’une
fontaine sur la place du village est
souhaitée « étant donné l’éloignement des
autres fontaines ». L’inventaire dressé au
début de cette étude se trouve donc confirmé
: il n’y avait aucun autre moyen de
desservir le cœur du village.
(2)La matière des conduites d’alimentation
Tantôt une phrase les confond avec la
mention qui est faite du bois nécessaire,
tantôt les deux sont distinguées. Les
conduites étaient-elles de bois ? En tout
cas il n’est nullement fait mention de
conduites en céramique.
(3) Le siphon et sa technique
La construction d’un pont est indispensable
sur la Monne pour permettre aux cultivateurs
saturninois de gagner leurs terres qui se
trouvent au-delà de cette rivière, sur les
flancs du Puy de Peyronère, mais aussi pour
servir de passage à l’eau de la source de
Sazeirat !
Voici enfin le mystérieux aqueduc, beaucoup
moins impressionnant qu’on le croyait :
c’est l’ensemble complexe de canalisations
passant sur le pont de la Fridière et menant
l’eau, grâce la pression générée par la
différence d’altitude entre la source et son
point d’arrivée, jusqu’au château d’eau.
Le château d’eau, lui-même élevé, permettait
à l’eau de couler vers la fontaine de la
Place de l’Ormeau.
Le principe du siphon (expliqué dans la
fiche supplément du n°343 de la revue Ar-chéologia),
déjà très utilisé par les Romains, n’est en
fait rien d’autre que l’application de la
loi des vases communicants, qui veut qu’un
liquide en équilibre atteigne le même niveau
dans deux récipients reliés par une tubulure
inférieure. Ce principe était autrefois
communément, bien qu’implicitement, appliqué
pour la distribution de l’eau dans les
villes par des tuyaux de plomb sous pression
partant de réservoirs hauts placés. Mais ce
sont seulement les réalisations à grande
échelle que l’on désigne sous le nom de
siphon, ou, si l’on veut préciser « siphon
inversé » pour le distinguer du « siphon
moderne » dont le coude est plus haut que
les extrémités.
Un siphon est donc constitué, d’un réservoir
de chasse, au départ (ici il devait se
trouver près de la source), et d’un
réservoir de fuite, à l’arrivée (c’est le
château d’eau en l’occurrence), reliés par
des tuyaux sous pression.
Le plus souvent un pont-siphon porte les
tuyaux au fond de la vallée. Sa fonction est
triple :
- il traverse le cours d’eau,
- il diminue la pression proportionnellement
à sa hauteur,
- et atténue les angles et les poussées à
ses extrémités.
La différence de niveau entre le réservoir
de chasse et le point bas du tablier du pont
est la flèche du siphon. Elle commande la
pression de l’eau, qui augmente de 1 bar
tous les 10 m. Du fait des frottements,
l’eau, qui coule continuellement, ne remonte
pas au niveau de son point de départ : il y
a perte de charge.
Sur un tracé qui ne laisse pas d’autre
choix, la vallée se présentant
incontournable au sens propre du terme, est
à la fois trop profonde et trop large pour
que la construction d’un pont-canal démesuré
soit envisageable, la solution est celle
d’une conduite forcée : un siphon.
Déjà sous l’Antiquité, Vitruve a évoqué la
traversée de vallées étendues avec des
tuyaux de plomb descendant directement la
pente jusqu’au fond, passant alors sur une
substruction de faible hauteur, qu’il
appelle « ventre », leur évitant un coude
brusque et le risque d’éclatement qui en
résulte, et remontant l’autre versant (De
l’Architecture, Livre VIII, VI, 5-6).
La mise en œuvre d’une conduite sous
pression suppose, de la part des ingénieurs
et des constructeurs, une grande expérience,
et elle exige une maîtrise technique de haut
niveau. Aussi les siphons furent-ils peu
nombreux dans le monde antique (il y en a eu
six à Lyon, surnommée la capitale du
siphon), et certainement moins encore à la
fin du Moyen-âge.
Ce n’est qu’à la fin du texte qu’une
allusion est faite au château d’eau, puisque
l’on parle du « réservoir ». L’hypothèse de
sa construction au début du XVIème siècle
tient-elle toujours ? Pourquoi pas puisque
ce réservoir préexiste en 1696, et
l’installation doit être réparée parce
qu’elle ne fonctionne plus depuis longtemps.
Cela ferait donc déjà presque deux siècles
que le siphon fonctionnerait.
LES PROJETS DE L’AN 1738
La Monne a-t-elle encore emporté le
pont ? L’ensemble n’a-t-il pas été
entretenu ? Toujours est-il que le
pont de la Fridière et la source de
Sazeirat sont totalement détruits
une nouvelle fois.
Après avoir délibéré avec leur
seigneur qui est désormais le
Marquis de Broglie, les Saturninois
adressent une supplique à
Monseigneur l’Intendant d’Auvergne
afin d’obtenir l’autorisation
nécessaire à la réalisation des
travaux. Ils bénéficient ensuite
d’un devis estimatif établi par un
entrepreneur clermontois. |
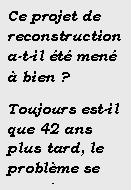 |
Supplique à
Monseigneur l’Intendant d’Auvergne
Elle ne nous donne qu’une seule information
vraiment intéressante, c’est la référence,
malheureusement très vague, à la dernière
destruction du pont de la Fridière.
« Supplient humblement les habitants du lieu
de Saint Saturnin, disant la nécessité dans
laquelle ils se trouvent de faire rétablir
une fontaine et construire en même temps un
pont lesquels se trouvent détruits depuis
plus de dix années... »
L’ordonnance de
l’Intendant d’Auvergne
Date-t-elle de 1733 ? L’avant-dernier
chiffre n’est pas lisible. L’accord y est
cependant donné, on peut penser qu’il a eu
lieu préalablement à l’établissement du
devis.
Voici sa consistance :
« Ordonnons que (...) d’un pont sur la
partie la plus convenable du ruisseau appelé
de la Monne qui est au-dessous du village de
Saint Saturnin comme aussi des ouvrages
nécessaires pour la conduite des eaux depuis
la source qui est au-delà de ladite rivière
jusqu’au milieu de la place la plus comode
dudit lieu pour y estre construite une
fontaine... ».
Devis estimatif
de la fontaine et du pont
par François Raimbaud
« Aujourd’hui, vingt-cinq septembre mil sept
cent trente huit
Nous François Raimbaud, entrepreneur
d’ouvrage en la ville de Clermont Ferrand,
expert nommé par monsieur Tournadre
subdélégué de monseigneur l’intendant tant
pour faire visite du pont et de la fontaine
de Saint Saturnin que pour en dresser un
devis estimatif des réparations urgentes et
nécessaires pour leur établissement, ou nous
étant transportés sur les lieux contentieux,
après avoir fais assembler les consuls en
charge et les principaux habitants au son de
la cloche, à la manière accoutumée, nous
leur avons déclaré que nous allions
travailler …nous étant transportés au pont
et à la source de la fontaine nous avons
remarqué que l’un et l’autre est entièrement
détruis et que le tout a besoin de rétablir
a neuf, après avoir le tout bien examiné et
murement réfléchy nous avons fait le devis
qui suit.
Premièrement
Sera fait une tranchée dans les terres
depuis la source de la fontaine jusqu’à
quarante toizes de l’ancien pons en suivant
le même chemin des anciens cannaux de la
fontaine ; la partie a deux cent dix toizes
de longueur qui sera creusée de quatre pieds
en carré
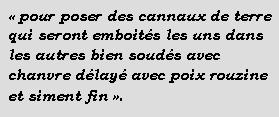
S’il se trouve dans la partie des anciens
cannaux qui ne soient pas endommagés ils
resserviront (1)
Après que les cannaux auront été posés et
bien mastiqués comme il vient d’être
expliqué l’on fera une maçonnerie de chaux
et sable de six pouces d’épaisseur tout
autour pour mieux conserver les cannaux et
empêcher le pois de la terre qui sera dessus
ne les puisse casser (2) ; ensuitte l’on
recomblera toute la tranchée sur les cannaux
avec la même terre qui en sera provenue
ensuitte sera fait un regard au bous de
dix-huit pouces encarré dans lequel regard
sera mis une ventouze pour donner de l’air
au cannaux afin que la force de l’eau ne les
puisse endommager.
Après sera mis au bous de la partie un tuyau
de plomb coudée pour faire prendre un autre
chemin plus cour que l’ancien (1) a la
fontaine ; depuis ce coudde jusqu’au
ruisseau ou sera placé le nouveau pons,
environs quarante toizes au-dessous de
l’ancien sera fais dans la partie qui a cens
toizes de longueur une tranchée dans la
terre de quatre pieds en carré dans laquelle
sera mis des cannaux de terre emboittés les
uns dans les autres souddés, maçonnés
autour, et recomblés de terre comme il a
déjà été fait cy-devant, on observera de
faire un regard au bout de la partie de
dix-huit pouces en carré dans lequel regard
sera mise une soupape à cause de la rapidité
de l’eau descendant de la montagne, les
tuyaux estant conduits jusqu’au ruisseau on
fera le rétablissement du pont qui aura
vingt pieds d’ouverture pour le passage de
l’eau et douze pieds d’une terre à l’autre
pour le passage des voitures, vingt-deux
pieds de hauteur au-dessus de la voutte
dudit pont, et pour sa construction sera
fais fondations décalées, lesdites tranchées
auront chacune douze pieds et demy de long
trois pieds de profondeur douze pieds de
largeur du devant au derrière de la culée.
Après que les tranchées auront été faites
comme il vient destre expliqué l’on remplira
en maçonnerie lesdites fondations bien
deniveau jusques au dessus des basses eaux ;
ensuite sera mis deux pièces de bois de
chesne de sept pieds par chacun un bout dans
les murs de culée, le long desquelles pièces
de bois sera battu des pal planches avec un
gros maillet pour les faire entrer de trois
pieds de profondeur, lesdites palplanches
seront arrettées avec des chevilles de fer
aux pièces de bois qui prenent dans les deux
culées ensuitte sera fait un pan en pierre
qui seront posées sur le champs en mortier
de chaux et sable pour empêcher que l’eau ne
puisse endommager les fondations ny creuser
sur ledit pont.
Ensuite sera élevé les murs de culée de
chacun vingt deux pieds de hauteur, dix
pieds d’aipaisseur et douze pieds de
longueur d’une teste à l’autre, en
observant de mettre des pierres de taille
aux quatre encoignures des quatre cu-lées.
Après que les culées auront été construites,
on fera la voutte du pont en plain caintre
construite en pierres plates des plus
grandes qui sera pourra trouver posées sur
les caintres en bain mortier de chaux et
sable en observant de faire les deux testes
dudit pons en pierres de taille de volvic.
Le pons étant fait comme il viens d’estre
expliqué, on fera une chaussée du cotté de
bize pour attraper la mon-tagne de Saint
Saturnin de huit pouces de pente par toize,
le pons et la chaussée étant finie, on
continuera les can-naux de la fontaine qui
passerons sur le pont et suivrons le long du
chemin yront jusques a une place publique
devans le château ou sont assis les vestiges
de l’ancienne fontaine. La partie depuis le
pons jusques à la place publique qui sera
creusée de quatre pieds en carré dans le
gorgue et dans le rocher pour placer des
cannaux de terre qui seront emboités les uns
dans les autres souddés avec chanvre fin et
bien délayés avec siment et poix rouzine,
ensuitte on fera une maçonnerie de neuf
pouces au pourtour des cannaux après on
recomblera la tranchée avec le même gorgue
ou rocher qui en sera provenu, observant de
construire un regard de dix-huit pouces en
carré dans le milieux de ladite partie, dans
lequel regard sera mis une soupape pour
servir de ventouse et empêcher que les
cannaux ne puissent être endommagés par la
force de l’eau.
Après que l’eau aura este conduite au lieu
destiné ou doit estre la fontaine
la fontaine sera pavée en pierre de taille
qui seront posées en bain dans le mortier de
siment ensuitte sera fais les joints aussi
en mortier de siment a toutes les pierres
autour de la fontaine pour empêcher que
l’eau ne puisse s’imbiber autour du bassin.
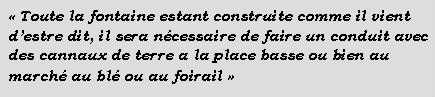
…la ou il sera fais un bassin de pierre de
dix pieds en carré pour recevoir par ces
cannaux le trop-plein de la fontaine qui
servira pour abreuver les bestiaux du
quartier bas de Saint Saturnin et dument
fais et fournis par l’entrepreneur le tous
sujet a visitation d'expert ou de gens a ce
connaissant moyennant le prix et somme de
huit mille deux cent cinquante livre a la
charge pour l’entrepreneur de faire aller
et entretenir ladite fontaine pendant un an
a ses frais et depans de tout quoy nous
avons dressé le présent procès-verbal pour
valoir et servir ce de raison et avons signé
lesdits jours et an ».
F. Raimbaux
Commentaire du devis de 1738
(1) L’itinéraire change
L’entrepreneur propose de ne pas construire
le nouveau pont à l’emplacement de l’ancien,
mais plus loin, à 40 toizes, c’est-à-dire 78
mètres, et sans doute en contrebas par
rapport à l’ancien puisque le trajet des
canalisations va être modifié. Il suivra
cependant, à partir de la source et sur une
certaine distance, le chemin d’origine des
conduites, si bien que les anciennes
conduites non endommagées seront conservées.
Au bout de 410 mètres (210 toises), à l’aide
d’un tuyau de plomb coudé, il fera prendre
un « autre chemin plus court que l’ancien »
pour arriver directement à la fontaine de la
place de l’Ormeau. Désormais le château
d’eau ne servira plus et les habitants du
Château fort (ses seigneurs n’y viennent
plus), devront comme les villageois aller se
servir à la fontaine.
Le château d’eau
aura donc servi pendant plus de deux
siècles, au gré des crues de la Monne, pour
finalement être abandonné pour plus de
facilité.
Le pont de cette époque était-il à
l’emplacement de l’actuel pont de la
Fridière ? Si tel n’est pas le cas, ce qui
est vraisemblable puisqu’il date de 1846, il
ne devait pas en être loin. En effet, le «
plus court chemin » s’efforçait sans doute
de suivre autant que possible une ligne
droite entre la source et la fontaine, et le
pont actuel se trouve dans cet alignement.
Mais ensuite, une fois le pont franchi, par
où donc passait l’eau ? On peut là encore
s’imaginer que la logique lui aura fait
suivre le chemin passant encore aujourd’hui
sous le château fort, ou bien plus
directement à travers bois, vignes ou
jardins d’autrefois.
(2) Conduites et constructions
L’explication minutieuse et détaillée qui
est donnée de la forme des conduites (elles
« s’emboîtent » les unes dans les autres),
leur joint de chanvre, la maçonnerie qui est
faite autour d’elles correspondent tout à
fait à ce qui a pu être observé sur le
terrain (cf. infra). La conservation
d’anciennes conduites et l’installation de
nouvelles explique peut-être la variété des
couleurs des conduites découvertes.
Il est tenu compte de la pression exercée
par l’eau sur les conduites puisqu’elles
seront enchâssées dans une forte maçonnerie
creusée « en carré » avant de se trouver
recouvertes de terre. Par ailleurs, de place
en place sont pratiqués des regards et des
ventouses (orifices de prise d’air d’un
conduit), afin de relâcher un peu du
trop-plein de pression.
Enfin le siphon en est réduit à sa plus
simple expression : l’eau de source arrive
directement à la fontaine qui devient à
cette occasion le « réservoir de fuite »,
dont le trop-plein se déversera en
contrebas, le village s’étant développé,
dans un bassin destiné à abreuver les
animaux.
Un peu de vocabulaire …
Une toise vaut 1,949 mètres.
Un pied vaut 12 pouces soit 32,48
centimètres.
Un pouce vaut 2,707 centimètres.
La culée d’un pont est l’appui d’extrémité
d’un pont, un mur de front et des latéraux
dits « en ailes » ou « en retour » suivant
leur implantation.
BILAN
La découverte de ces textes a été une
véritable chance et a permis de rectifier
l’idée que l’on se faisait de l’aqueduc de
Saint Saturnin et confirmer son existence de
manière irréfutable. Un point reste encore à
éclaircir : la datation. A partir de quand
le siphon a-t-il été utilisé et le château
d’eau construit ? Fait-on alors appel à des
ingénieurs spécialisés ou bien ce type
d’installation est-il chose courante en
Auvergne ou en France à cette époque ?
Le fait est que la date de la fin de service
du château d’eau nous est donnée : dès le
début du XVIIIème siècle, il est abandonné.
LES TRAVAUX DE LA PLACE DE L’ORMEAU
La place de l’Ormeau est celle où siège la
fameuse fontaine due à la famille de La Tour
d’Auvergne. Durant l’hiver 1996-1997, elle
s’est vue transformée en un véritable «
champ de tir », duquel on pouvait espérer
obtenir quelques vestiges de conduites d’eau
venant corroborer les dits des textes de
1696 et 1738.
De tranchée en tranchée, nos attentes ont
fini par être totalement comblées.
Une tranchée pour
l’électricité
Le 6 novembre 1996, une tranchée est
réalisée le long de la maison de Monsieur
Cellier (où se trouve l’ours en buis) jusque
devant la fontaine. La nuit étant tombée
lorsque nous avons pu nous y rendre, aidés
par la lueur d’une petite lampe électrique,
nous n’avons pas été déçus par notre
expédition nocturne.
La plus étonnante de nos découvertes fut
sans aucun doute une pierre rectangulaire
dont la partie centrale avait été creusée en
une forme trilobée. Encore en place, elle
ouvrait sur un conduit construit de pierres
et de mortier qui s’en allait suivant l’axe
fontaine-chemin sous le château. Monsieur
Cellier en a donné une explication qui
semble très probable : ce conduit devait
mener l’eau du trop-plein de la fontaine
jusqu’à la citerne dont il connaît
l’existence dans la direction justement
prise par le conduit.
Jouxtant sa paroi gauche, une conduite a été
fracassée, elle continue en face, sur
l’autre flanc de la tranchée, en direction
de la fontaine. Il semble que la cause de sa
destruction ait été l’aménagement du conduit
dont nous venons de parler. Ces morceaux ont
cependant quelque chose de merveilleux : un
intérieur vernissé et surtout, à
l’intérieur, une pellicule de calcaire de
quelques millimètres d’épaisseur !
Aucun doute n’est donc plus permis, l’eau de
Sazeirat est bien arrivée un jour jusqu’à la
fontaine ! D’où pro-venait-elle ? Du château
d’eau ou de la source directement ?
Impossible de le déterminer à l’aide de ces
seuls fragments.
Une tranchée pour le tout-à-l’égout
Le 22 février 1997, une nouvelle tranchée
est faite entre la fontaine et le chemin
longeant le ravin de la Monne.
L’envoyé spécial de ce jour, Grégoire
Guillaumont, très vite rejoint par Monsieur
Bernard Cellier, va y mettre son nez, et
observe des choses qui deviendront claires
par la suite : « un mur coupé partant en
direction du château, d’environ 80
centimètres de large, coupé sur un mètre de
profondeur, mais qui est plus profond car au
sol on voit de la chaux. (…) En direction de
la fontaine, sur la gauche, dans un gros tas
de cailloux, on a trouvé un morceau de
conduite en terre grossière vernissée marron
avec calcaire à l’intérieur (c’est une
extrémité), de l’autre côté, autre morceau
de conduite dans un gros tas de cailloux
liés à la chaux. Les conduites sont à
environ 30cm sous le niveau actuel de la
place ».
Le coup de théâtre
Surveillés quasiment au jour le jour, les
travaux de dégagement de la place ne nous
apprennent rien de plus, les découvertes
semblent être terminées. Les irrégularités
de la terre sont aplanies, tout est prêt
pour le re-goudronnage, et .
Lundi 2 mars 1997, coup de téléphone de
Monsieur Cellier : de nouveaux trous ont été
faits sur la place, et des conduites sont
apparues
Ni
une, ni deux, nous voilà.
Devant le portail du château,
sur la partie gauche, la
pelleteuse a carrément sorti un
bloc rectangulaire de pierres
liées entre elles par du
mortier, enserrant une conduite
en céramique. Elles ont
exactement la même forme que
celles signalées au réservoir et
au château ! |

Ce bloc de
pierres liées par du mortier
enserre une conduite |
Ultime vérification : il y a bien une
pellicule de calcaire sur leur paroi
interne. Leur couleur varie : il y en a des
vert-bouteille, des jaune-beige, des
marron-rouille. Au niveau des deux parties
s’emboîtant, de la terre glaise rouge a été
appliquée comme renfort d’étanchéité, et
pour qu’elles restent en place, l’intérieur
des extrémités a été strié.
La section des blocs de pierres agglomérées
entourant les conduites mesure 74 cm de
largeur et 30 cm de hauteur. Ce sont là les
mêmes mensurations que celles de cet étrange
mur découvert dans la tranchée précédente !
On retrouve ici le procédé décrit par le
sieur Raimbaud dans son devis en 1738 : les
conduites avaient été installées au milieu
d’un appareillage de pierres liées par de la
chaux dans un trou fait en carré.
La preuve est cette fois-ci certaine :
l’eau, captée à Sazeirat, était conduite au
château d’eau, traversait le parc, puis la
cour intérieure du château fort pour aboutir
à la fontaine.
|

La voûte de
Sazeirat dégagée
|
LES VESTIGES
DE SAZEIRAT
Forts de toutes ces découvertes au
village de Saint Saturnin, il nous
brûlait de savoir ce que pouvait
bien abriter la construction voûtée
à moitié enterrée située sur le
terrain d’émergence de la source de
Sazeirat. Cet édifice avait
certainement un lien avec le captage
de la source : on pouvait penser
qu’il abritait un bassin, de
décantation ou permettant la
formation de la pression nécessaire
à sa conduite par siphon…
De là est partie l’idée de demander
l’autorisation de procéder à des
fouilles archéologiques…
Le terrain concerné appartient à
Monsieur Michel Aubry, qui a eu la
gentillesse de tout de suite
accepter notre projet et de nous
débroussailler immédiatement toute
la zone en cause. |
|
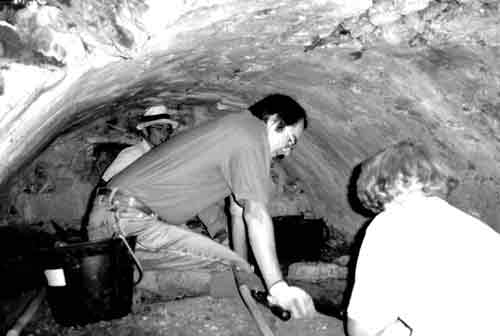
Fouilleurs à l’intérieur de la
structure
Suite à cette
première autorisation, Madame
Fizellier-Sauget, ingénieur de
recherche à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Auvergne
(DRAC) nous a indiqué
qu’entreprendre des fouilles ne
serait possible qu’avec la
supervision d’un responsable agréé
par la DRAC. Elle-même accepta de
demander une autorisation de
fouilles en son nom.
La voûte de Sazeirat dégagée
Monsieur Leguet, vice-président de
l’Association du Site de Gergovie (ASG),
est également responsable du Service
Educatif d’Archéologie du Puy de
Dôme. Il voulut bien s’investir dans
ce chantier de fouilles en tant que
responsable et plusieurs membres de
l’ASG acceptèrent de participer à
l’opération pour les deux jours
prévus, qui durent être rallongés…
Ainsi fin août 1997, un périmètre de
fouilles commença à se dégager
autour de la voûte émergeant à
Sazeirat.
LA REMISE A NIVEAU
Le plus gros travail est la « remise
à niveau » qui consiste à enlever la
terre qui s’était accumulée au fil
du temps, et de retrouver le sol
d’origine. Très rapidement on
retrouve la base du mur de façade
fermant la construction, dans lequel
devait être aménagée une ouverture
pour entrer à l’intérieur, le reste
de la construction étant enfoui dans
la pente naturelle du terrain.
Restait donc à dégager l’intérieur
de la construction et à découvrir ce
que protégeait cette voûte. Le
décapage, toujours fait par couches
horizontales régulières afin de
pouvoir observer les apports
successifs en remblais, nous fait
apparaître un muret suivant la forme
rectangulaire de la structure : on
songe au pourtour d’un bassin. Suit
donc la phase de décaissement, des
remblais l’ayant totalement comblé.
Il s’agit a priori d’un remplissage
volontaire avec des pierres qui
de-vaient gêner dans le terrain, ou
prove-nant du mur de façade
effondré.
Et finalement, c’est bien un bassin
qui apparaît, parfaitement bien
conservé par un comblement sans
doute rapide…
|
UN BASSIN
Ce bassin est une construction
habile, dont l’étanchéité était
parfaitement assurée, mais révélant
curieusement deux conduites de
départ, et laissant encore un gros
point d’interrogation sur l’arrivée
de l’eau.
Une étanchéité assurée
Les murs du bassin doublent ceux de
la construction le protégeant, mais
entre eux, un espace d’environ 50 cm
a été comblé, à la manière de la
double paroi du château d’eau, d’une
terre glaise dense et marron.
Par ailleurs leur paroi interne est
recouverte d’un enduit rose. Les
fragments retrouvés dans les déblais
du bassin semblent indiquer que le
bassin ne devait guère être plus
haut, mais que sa margelle en était
recouverte également.
Le sol est fait de belles dalles en
pierres de Volvic, et le joint entre
elles est également assuré par de la
fine terre argileuse.
Deux conduites
Le bassin
A l’intérieur du bassin, dans la
partie de son muret s’appuyant sur
le mur de façade de la structure,
nous nous étonnons de trouver
l’emplacement de deux conduites et
non d’une seule comme on le
prévoyait. On attendait des
conduites en céramiques, comme
celles observées précédemment à
Saint Saturnin, mais rien de tel en
fait … |

Le bassin |
|
I
Le sol du bassin et les départs de
deux conduites |
Il y a une
petite marche rectangulaire en
volvic presqu’au centre de la base
de cette paroi, et de chaque côté
deux trous parfaitement ronds dans
le mur de façade, se prolongeant
dans le bassin par les emplacements
encore arrondis correspondants, et
se terminant chacun par un grand
cercle de fer. L’un est brisé,
l’autre encore entier. Il s’agit là
à l’évidence des emplacements
d’anciennes conduites en bois (nous
retrouvons des « miettes » de bois à
leur emplacement), dont l’extrémité
aboutissant dans le bassin était
renforcée par un cerclage en fer.
Leur étanchéité était assurée
au-dessous par de la glaise blanche
et la « marche » centrale soutenait
le bois contre la force de l’eau.
Elles avaient certainement été
enduites de la même manière que les
parois du bassin pour finir de les
stabiliser.
Un élément vient renforcer la thèse
de l’emploi du bois pour ces
conduites : dans le remplissage du
bassin ont été trouvés des fragments
de gangues intérieures de calcaires,
incurvées selon le diamètre indiqué
par le trou du mur du bassin. On
peut de plus deviner, sur leur face
extérieure, les striures du bois des
conduites. |
| |
|
|
L’arrivée
d’eau
Le moyen utilisé pour faire arriver
l’eau jusque dans le bassin n’a pu
être découvert. Pourtant il y a,
dans le mur du fond de la voûte une
niche dont le pourtour est
parfaitement délimité par des
pierres appareillées. Aujourd’hui
niche du fait d’éboulements, elle
devait en fait être à l’origine le
point d’arrivée d’un tunnel menant
l’eau captée en amont.
La tentative de dégagement du
prétendu tunnel ne nous livre guère
de renseignements : il y a eu un
éboulement récent et des pierres de
la surface sont venues tout combler.
Par ailleurs, l’écoulement de la
source a dû continuer un temps après
son abandon et le calcaire qu’elle a
déposé a fini de tout agglomérer.
Autre question : comment faisait-on
franchir à l’eau la distance
niche-bassin ? La réponse doit
certainement se trouver dans une
construction en matériaux
périssables dont il ne reste aucune
trace aujourd’hui, car la paroi du
bassin en contrebas est parfaitement
lisse, sans aucune trace d’arrivée
d’eau.

Au fond de la voûte, « la niche »
Cependant,
dans les montants de la « niche »,
une pierre intrigue : elle est
percée d’un trou parfaitement rond
de 16 cm de diamètre, qui lui-même
est percé verticalement à
l’intérieur, sans que l’on puisse
parvenir à en toucher le fond. Quel
était son rôle ? Tout laisse à
penser qu’il a bien été mis à
dessein dans la construction ;
serait-ce l’emplacement destiné à
l’éclairage de la pièce ?
LA FAÇADE
Les traces de conduites en bois
découvertes à l’intérieur du bassin
étaient bien plus basses que le
sondage effectué précédemment à
l’extérieur, le long du mur de
façade. Nous continuons donc à
dégager ce mur de façade pour
retrouver les conduites à leur
sortie du bassin.
Une partie enterrée
Les conduites sortantes devaient
être enterrées à l’époque de leur
utilisation pour une meilleure
protection. Cela nous est confirmé
par la découverte d’un amoncellement
de pierres avec peu de terre entre
elles avant de parvenir au niveau
voulu, et parmi lesquelles on
continue à trouver des tessons de
céramiques.
Très vite, nous repérons
l’emplacement des deux conduites :
il y a un bâti central, et de chaque
côté de ce dernier, on rencontre une
fine couche de terre glaise de
couleur claire. Sous le mur de
façade, nous retrouvons un cerclage
de fer destiné à la conduite de
gauche et des petits cailloux sans
doute là pour la caler avec
précision.
Chose étonnante, on ne retrouve pas
de cerclage à droite, alors qu’à
l’évidence, il y a bien une sortie
pour la conduite observée à
l’intérieur du bassin. Seule une
pierre plate et quelques autres
semblent vouloir former un conduit
sommaire.
Et la suite ?
En y regardant de plus près, le
cerclage de fer de gauche est double
: la conduite observée à l’intérieur
du bassin, d’un grand diamètre
(15-16 cm), recevait sans doute une
autre d’un plus petit diamètre
(12-13 cm) qui s’emboîtait dedans
(une « réduction »).
A partir de cette trouvaille, nous
nous demandons s’il ne serait pas
possible de retrouver le cerclage de
la conduite suivante, un peu plus
bas. Pour estimer la distance, nous
mesurons celle entre le cerclage du
bassin et le cerclage double : 1 m
20. Nous reportons la mesure au-delà
des deux cerclages emboîtés.
Nous avons remarqué, dans
l’alignement des deux derniers
cerclages, un trou parfaitement rond
:
|

Le dernier cerclage trouvé
dans l’empreinte des
conduites |
l’empreinte laissée par la
conduite en bois qui en
partait. Cela se vérifie
puisqu’en glissant la main à
l’intérieur, elle rencontre
un nouveau cerclage ! La
terre n’avait donc pas été
remuée à cet endroit depuis
l’époque où l’installation
fonctionnait. Il est
exactement à 1 m 20 des
précédents.
Une fois dégagé, ce cerclage
a le même diamètre que le
plus petit des deux
derniers, mais il est seul :
il n’y a pas de trace d’une
autre conduite. Le système
ne se perpétue donc pas. On
ignore comment l’eau pouvait
continuer son trajet, mais
tout semble indiquer que
c’était cette conduite qui
allait ensuite rejoindre le
château d’eau…
A droite, la sortie de la
conduite ne nous en apprend
pas d’avantage : il s’agit
d’un conduit construit avec
des pierres à peine
dégrossies et dont le trajet
semble être parallèle à
celui de gauche. La seule
explication que nous ayons
pu trouver à son sujet est
celle d’une vidange du
bassin. A ce moment-là en
effet, peu importait que la
conduite fût étanche ou non.
|
BILAN
Le bilan de ces fouilles se traduit
par :
Des chiffres.
Maintenant que le bassin nous est
connu et que nous avons pu le
mesurer sous toutes les coutures,
les « matheux » de notre équipe ont
pu se livrer à quelques calculs.
Ainsi, en prenant à chaque fois la
capacité maximale du château d’eau,
des canalisations et du réservoir de
chasse (notre bassin), on peut
appliquer la théorie du siphon et se
rendre compte que :
le château d’eau étant à une
altitude approximative de 530 m,
d’une contenance d’environ 491 800
litres (si on considère que le
niveau de l’eau montait jusqu’à 2,10
m dedans), son temps de remplissage
avec le débit calculé de la source
aurait été d’à peu près 5,7 heures ;
Le dernier cerclage trouvé
dans l’empreinte des conduites
le réservoir de chasse étant à une
altitude approximative de 590 m, et
d’une contenance d’environ 1 800
litres, le débit de la source au
niveau de la canalisation de départ
aurait été de 24 litres/secondes
(bon débit !), si bien qu’en une
journée la source aurait fourni 2
068 m3 et que la poussée au niveau
du pont de la Fridière aurait été de
118 tonnes/m2, soit 11,8 kg/m2.
Des questions
- Peut-être un progrès dans la
datation des constructions.
En effet la similitude
d’architecture entre la voûte et le
château d’eau (mortier, doubles
parois remplies de terre), laisse à
penser que les deux pourraient être
effectivement contemporains.
L’apparition de la fontaine étant
liée à celle du château d’eau, il ne
semble pas trop hasardeux de les
situer tous trois au début du XVIème
siècle.
- Des questions supplémentaires sur
la manière dont l’eau pouvait être
conduite jusqu’au château d’eau :
pourquoi trouve-t-on au bassin des
conduites en bois alors que partout
ailleurs elles sont en céramique ?
- Tout le trajet de la source en
amont du bassin reste dans l’ombre :
où la source était-elle captée,
comment était-elle menée jusqu’au
sarcophage qui longtemps a servi
d’abreuvoir, ensuite conduite
jusqu’au bassin ?
Enfin, on voudrait fouiller encore
un peu au-dessus, un peu au-dessous…
Et puis il y a aussi cette autre
cabane, juste à côté de la voûte,
tellement souvent gorgée d’eau,
qu’elle a sûrement de belles choses
à raconter sur l’histoire de la
source de Sazeirat. On est tenté de
penser a priori que sa construction
pourrait bien être liée à l’abandon
de la structure en voûte. Oui, mais
alors, quand donc ?
LA DERNIERE CHANCE DE LA SOURCE
DE SAZEIRAT
Une visite supplémentaire aux
Archives Départementales a suffi à
apporter des informations tout à
fait inattendues. Une délibération
du Conseil Municipal datée du 28
octobre 1853 indique qu’il faudra
procéder au remboursement de
Monsieur Villot, lequel avait avancé
la somme nécessaire à la
construction d’un pont sur la Monne
à la Fridière, le pont de bois le
précédant ayant été enlevé par la
rivière, « considérant aussi que
pour la conduite des eaux
nécessaires à l’établissement des
fontaines à Saint Saturnin, elle
utilisera encore ce pont ».
Surprise, le pont datant de 1846,
encore debout aujourd’hui, a
lui-même été prévu pour le passage
de l’eau de Sazeirat que l’on
envisageait d’amener encore au
village
En 1854, le maire, Monsieur
Cho-mette, veut faire construire des
ponts à Saint Saturnin et y ramener
l’eau. Il y a un problème avec
Monsieur Villot qui habite Saint
Amant et qui ne veut pas que les
conduites « en tôle bitumée »
passent sur son terrain, sachant que
« les tuyaux de la conduite des eaux
à l’établissement des fontaines
doivent passer sur un pont placé sur
la rivière Monne au terroir de la
Fridière ».
Et suivent les différents devis
relatant les différents travaux
nécessaires (dans l’ordre) :
- fouilles dans le pré de Monsieur
Mège pour recueillir l’eau,
- château d’eau au départ A,
- vidange,
- 1ere partie de conduite,
- 2ème partie de conduite,
- 3ème partie de conduite descendant
au pont de la Monne,
- 4ème partie de conduite remontant
au village,
- fontaine B, etc …
Le fameux château d’eau « au départ
A » est à construire, il s’agit à
coup sûr de la cabane dont nous
parlions précédemment, située à côté
de la voûte.
Le financement de tous ces travaux
nécessite une imposition
extraordinaire à Saint Saturnin par
la commune. Et les premières
fontaines (il y en a plusieurs à
construire dans le village) prévues
étant trop petites pour « la
multitude des bestiaux » du village,
le projet est révisé.
Finalement le 28 août 1857, on
constate que depuis 3 mois les
nouvelles fontaines sont à peu près
terminées, sauf une car les
habitants s’y opposent, la trouvant
trop petite pour leur quartier, et
ils menacent de faire violence si
cela n’est pas changé.
En 1871, la source de Sazeirat ne
suffit plus, alors une autre
direction est prise et le Conseil
Municipal délibère sur «
l’opportunité de faire la recherche
de sources d’eau pour alimenter les
fontaines de la commune qui en
étaient presqu’entièrement
dépourvues, le conseil considérant
que le chef-lieu de la commune est
totalement privé d’eau et qu’un
ingénieur hydroscope se charge de
lui en fournir une quantité qui
pourra amplement suffire à tous les
besoins moyennant la somme de 15000
francs ».
En 1874, on demande des fonds
supplémentaires car « tout est tari
», pour continuer les fouilles
commencées « pour la recherche d’un
peu d’eau alimentaire » dont la
commune est totalement dépourvue.
En 1876, le chef-lieu de la commune
(toujours Saint Saturnin, car
Chadrat est pourvu de nombreuses
sources) n’a pas d’eau potable et ne
trouve pas des ressources
suffisantes pour s’en procurer
malgré les plaintes des habitants.
Finalement, le 10 juillet 1880, est
dressé un « acte public par lequel
des habitants ou propriétaires
domiciliés à Saint Saturnin, au
nombre de 212, sont constitués en
société civile à l’effet d’opérer
dans cette commune des travaux de
recherche d’eau de source et font
cession gratuite de l’eau captée
ainsi que de tous leurs droits sur
les canaux, tuyaux de conduites et
autres ».
C’est le point de départ du captage
de Cladeyrat. Mais ceci est une
autre histoire…
Armelle
Guillaumont
|
Autorisation de parution donné pour le site
internet des Amis de Saint Saturnin
Copyright © Association du Site de Gergovie®
(Bulletin de l’Association du Site de
Gergovie n° 17 – juin 1999). Tous droits
réservés.
|